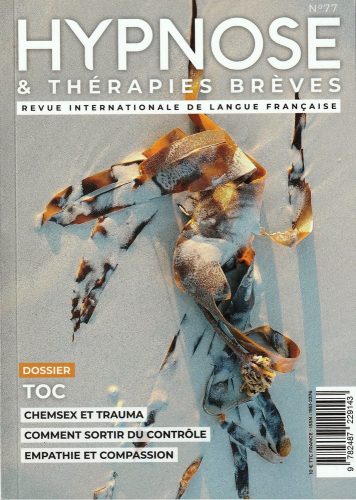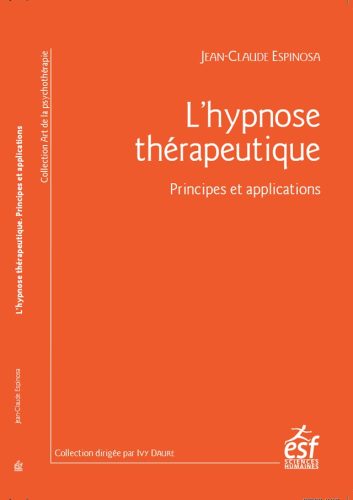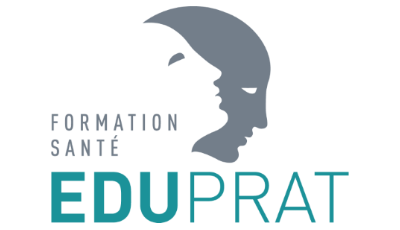La chronique du Dr Bruno Blaisse, Responsable média de l’ IMHE Biarritz Pays Basque – Hypnosium
PREAMBULE :
Ces dossiers sont très incomplets et sans prétention car je les renseigne au fur et à mesure de mes lectures, n’y voyez aucun parti-pris…EDITORIAL : 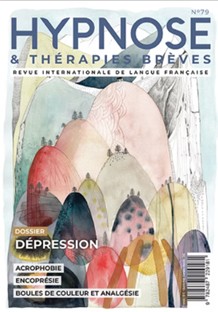
Ce mois-ci évidemment j’ai donné une grande place au compte rendu des 13èmes Journées Hypnotiques de Biarritz toujours aussi sympathiques et innovantes avec en prime de nombreuses nouvelles vidéos à découvrir sur le site d’Hypnosium.
Ce fut l’occasion de rencontrer Christian Straus*, pneumologue et professeur de physiologie à Paris, très impliqué dans la recherche autour de l’hypnose et créateur de la première Unité d’Enseignement « Introduction à l’hypnose médicale », formation optionnelle proposée en 2ème cycle des études médicales dont les notes sont prises en compte pour les notes finales des étudiant.e.s. Une belle rencontre et une découverte comme les JHB* savent les susciter.
Dans le numéro de Cerveau & Psycho consacré à l’insomnie j’ai été surpris de découvrir que le traitement par les TCC* comporte une prescription de tâche* paradoxale : la restriction de temps de sommeil !
Enfin si vous vous intéressez aux neurosciences je vous recommande de vous abonner (gratuitement) au podcast hebdomadaire Cérébral.
Bonnes vacances de Toussaint.
DANS LES KIOSQUES :
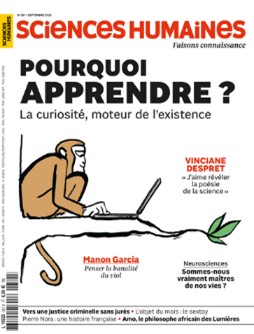
- Sciences Humaines. Septembre 2025. 6.9 €
- « Sommes-nous vraiment maîtres de nos vies ? » Cet article revient sur la théorie de Robert Sapolsky*qui considère que nos actions sont le résultat de processus inconscients et l’examine sous l’angle de vue philosophique : opposition entre « compatibilisme » (nous ne maîtrisons pas ce qui nous arrive mais la manière dont nous réagissons dépend de nous) et « incompatibilisme » (nous ne faisons qu’interpréter après coup ce qui nous arrive). Un grand débat philosophique.
- « Pourquoi apprendre ? La curiosité, moteur de l’existence ». Un grand dossier de 30 pages.
Au total : Avant tout philosophique.
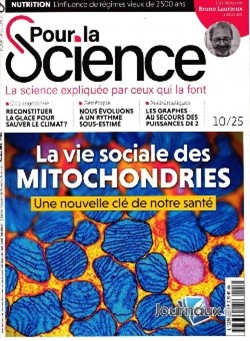
- Pour la Science. Octobre 2025. 7.5 €.
- « Santé mentale : quand la biologie éclaire les soins ». Cet article de quatre pages fait le point sur les connaissances actuelles des relations entre biologie et psychiatrie, avec un focus notamment sur les réactions inflammatoires, le TSA* et la schizophrénie*. A noter aussi la présentation du Suivi Thérapeutique Pharmacologique qui permet l’adaptation optimale pour chaque patient.e de traitements ayant souvent une marge thérapeutique étroite, l’insistance sur la période cruciale de l’adolescence et la nature multifactorielle des troubles psychiatriques.
- Le Hors-Série « La conscience » de Mai 2025 est joint gratuitement (11 €) sous emballage plastique en kiosque.
- « La vraie nature de notre conscience est discrète, au sens mathématique ». Long entretien (5 pages) avec Lionel Naccache* sur les notions de conscience et de subjectivité. Celui-ci explique : « Je m’inscris dans une longue tradition philosophique qui définit la conscience comme la capacité à se rapporter, subjectivement, c’est-à-dire à la première personne, un objet mental quel qu’il soit, comme : « Je vois cette tasse » ou « Je me souviens de… ». Il développe ensuite l’évolution des théories sur la conscience et particulièrement celle de l’espace de travail neuronal global* (que son équipe défend) mais aussi la théorie de l’information intégrée* de Giulio Tononi* avec leurs différences et leurs points communs. Il aborde de nombreux sujets comme le sommeil, le mind blanking*, les zombies philosophiques*, etc. Pour les relations entre le corps et la conscience sa position est médiane : « Pour arriver à construire cet objet mental qu’est le sujet conscient, je pense qu’il existe une période précoce qui requiert ces interactions entre le cerveau et le reste du corps, afin de faire émerger une représentation de soi. » Il termine en affirmant que : « La conscience (et la subjectivité) précède toutes les contraintes qui peuvent gêner son épanouissement. » Une lecture ardue mais passionnante.
- « Un dialogue intérieur vu de l’extérieur ». Lionel Naccache* explique comment les neuroscientifiques explorent le cerveau à partir de théories (ici l’espace de travail neuronal global*) et d’expérimentations. Il explique la différence entre éveil et conscience et le rôle de la formation réticulée et les découvertes récentes sur les périodes d’éveil durant le sommeil, mais aussi la notion de « connectivité fonctionnelle » et ce qu’est une « matrice ». Enfin il évoque la recherche de signatures physiologiques de la conscience et la relation étonnante entre le cœur et la conscience de soi.
- « La mort imminente, une porte vers la conscience ? » Cet article détaille les études scientifiques faites rétrospectivement sur des sujets ayant eu des expériences de mort imminente*, mais aussi les études prospectives réalisés sur des mourants (arrêt cardio-respiratoire) ayant survécu, en utilisant des enregistrements EEG *, des tests cognitifs, etc. Il signale une plus forte probabilité d’EMI* chez les personnes ayant des épisodes d’« intrusion du sommeil paradoxal » et un « recouvrement frappant » entre les expériences d’EMI* et l’exposition aux psychédéliques (DMT*).
- Dans la tête d’un zombie » ? Philip Goff* explique le mécanisme des recherches sur la conscience utilisant la notion de zombies philosophiques*, soit une entité complexe conçue pour se comporter exactement comme un être humain, avec le même traitement de l’information dans son cerveau, mais sans conscience… à la découverte du mystère de l’harmonie psychophysique* !
- « La guerre des cerveaux ». Je vous ai déjà signalé dans une autre revue cet article très instructif sur la violence des oppositions entre tenants des différentes théories de la conscience et la difficulté d’organiser une réunion de collaboration « adversariale » !
- « Toutes nos expériences conscientes trouvent leur origine dans cet impératif fondamental qui est de rester en vie ». Anil Seth* lui penche plutôt pour la théorie de l’information intégrée* mais insiste surtout sur les progrès de la science dans la connaissance de la conscience et le fait que la conscience et la vie sont étroitement liés. Il pense que : « La perception est une construction active dans le cerveau et que son but n’est pas de créer une représentation véridique et précise du monde réel, mais plutôt d’aider à la survie d’un organisme. Nous ne voyons pas le monde tel qu’il est, mais tel qu’il nous est utile. »
- « Une subjectivité artificielle ? » Christof Koch* revient sur l’opposition entre les deux théories principales de la conscience (GNWT* et TII*) et des conséquences quant à l’IA*et notamment la possibilité d’avoir, ou non, un jour une IA* avec une conscience (et donc des droits…).
- Et plein d’autres articles….
Au total : Un article pointu sur biologie et psychiatrie, mais surtout le Hors-Série sur « La conscience » gratuit qui justifie l’achat.
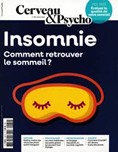
- Cerveau & Psycho. Octobre 2025. 7.5 €.
- « Trauma : vers un nouveau médicament ? » Une molécule coréenne qui agit sur le neurotransmetteur du cortex préfrontal* : le GABA.
- « Pourquoi certaines personnes n’ont pas d’images mentales ». Paolo Bartolomeo* explique que certains cas d’aphantasie* comportent un trouble des relations entre le lobe temporal inférieur gauche et le cortex préfrontal* gauche. Il plaide pour une détection de ce trouble (1 à 4% de la population) dès le début de la scolarité pour adapter les méthodes d’enseignement.
- « Bien dormir, enfin ! » Isabelle Poirot* fait un large rappel des notions fondamentales sur le fonctionnement du sommeil et les différents types d’insomnie. Elle présente ensuite la prise en charge des insomnies par les TCCi* qui donne 80 à 90 % de réussite au long terme en associant restructuration cognitive, restriction du sommeil, contrôle des stimuli et accompagnement thérapeutique. NB : Ce dernier point est fondamental pour adapter la thérapie au cas spécifique de chaque patient et non appliquer une recette trouvée dans une publication (style développement personnel*) comme le rappelle Yves-Alexandre Thalmann* dans son article de cette même revue.
- « Notre environnement n’est plus propice au sommeil ». Damien Léger* détaille tous ces phénomènes perturbateurs qui gâchent nos nuits, et en premier la lumière et le bruit. Il propose quelques solutions et regrette que le traitement par les TCCi* soit limité par le petit nombre de thérapeutes qualifiés.
- « Prudence ou excès de précaution ? » Christophe André* explique que la prudence consiste à agir après avoir évalué les risques et conséquences de ses actes (y compris pour les autres) et est une forme sobre et tranquille, non spectaculaire du courage.
- « Micro-habitudes : changer sa vie petit à petit ? » Cet article s’intéresse à une mode de développement personnel* et en précise les bases scientifiques et les limites. Une des clefs du succès consiste à lier la nouvelle habitude à une routine déjà existante (méditer après son café, etc.) ou à planifier clairement le lieu et le moment prévu pour la nouvelle habitude (10 pompes dans ma chambre tous les soirs à 19h30, etc.), mais le succès dépend surtout de la répétition, donc de la persévérance ,qui elle dépend de la motivation. Enfin supprimer une mauvaise habitude est encore plus difficile et dans ce cas il est souvent plus efficace de la remplacer par une autre moins toxique.
- « Encore un livre inutile ! » Yves-Alexandre Thalmann* dit tout le mal qu’il pense de certains livres de développement personnel*.
- « Le langage repose sur des biais cognitifs ». Isabelle Dautriche* explique les expériences qui ont permis de découvrir ce phénomène et notamment le fait que nous accordons plus d’importance à l’agent (l’acteur) qu’à l’objet en raison d’un biais attentionnel. Elle présente ensuite la construction du langage à partir de briques de base et le concept de compositionnalité*.
Au total : Un excellent article sur le traitement des insomnies.
- Cerveau & Psycho. Novembre 2025. 7.5 €.
- Un dossier sur le TDAH* dont je vous parle le mois prochain.
AIRES D’AUTOROUTE, OCCASIONS ET TROUVAILLES CHEZ LE BOUQUINISTE :
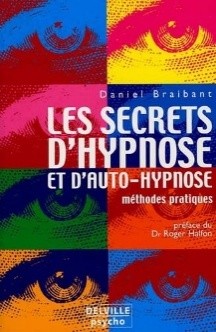 Les secrets d’hypnose et d’auto-hypnose. Daniel Braibant. Ed Delville psycho. (2005). 18.95/7 €. (170 pages).
Les secrets d’hypnose et d’auto-hypnose. Daniel Braibant. Ed Delville psycho. (2005). 18.95/7 €. (170 pages).
- Je pense que je souffre d’un début de biais cognitif* : quand je lis « secret » à côté d’« hypnose » je deviens méfiant et suspecte d’emblée le charlatan !
- Comme le livre décortiqué le mois dernier celui-ci date de 2000 mais présente des conceptions et techniques du début du siècle passé. Je dois toutefois reconnaitre qu’il est encore plus extraordinaire et présente une conception de l’hypnose particulièrement exigeante, proche du sacerdoce !
- En effet le candidat hypnotiseur doit tout d’abord se sevrer de l’alcool et du tabac (avec l’aide de l’homéopathie*), se purifier avec des cures d’argile verte, adopter un régime végétarien « souple », s’entrainer pendant 21 jours aux « passes magnétiques », arriver à rester 15 minutes yeux ouverte sans bouger les paupières, pratiquer le yoga (30 pages), etc.
- Evidemment il faudra aussi trouver des patient.e.s très patient.e.s capable d’accepter des inductions de 15 minutes par passes magnétiques et autres fixations prolongées.
- Moyennant quoi vous pourrez grâce à l’autohypnose découvrir la précognition, voir sur votre téléviseur ce que font d’autres personnes, lire dans les pensées d’autrui, voir « à travers les murs », attirer la personne de vos rêves et autres récompenses alléchantes pour vos efforts !
- Encore une fois quelques techniques possiblement intéressantes sont noyées dans un océan d’inepties, le seul mérite que je trouve à ce livre est son peu de dangerosité compte tenu des minuscules chances d’y apprendre une technique efficace et l’absence de techniques dangereuses (comme la compression carotidienne bilatérale ou le jeter de patient au sol qui figurent dans d’autres ouvrages).
- Dernier point : ce livre comporte une bibliographie qui réussit à ne citer aucune référence scientifique valable.
Au total : Une pièce de musée à réserver aux collectionneurs ayant le sens de l’humour.
PARU, PAS LU :
- « L’hypnose thérapeutique ». Jean-Claude Espinosa. Ed ESF. (30 Octobre 2025). 29 €. (280 pages).
- « Sexualités humaines ». Octobre 2025. 10 €.
THEATRE TELEVISION FILMS SPECTACLES EXPOSITIONS :
- « 13 novembre 2015 : que dit la science des attentats ? » Cité des sciences. Paris. Du 23 Septembre 2025 au 22 Mars 2026.
CONGRES, FORMATIONS, WEBINAIRES :
- « Le médecin dans l’accompagnement des souffrances et de la fin de vie ». Journée débat organisée par le Conseil National de l’Ordre des Médecins* le 05 Novembre de 09h à 17h45 à Paris. Inscription gratuite avant le 22 Octobre 2025.
COMPTE RENDU DE FORMATION :
- Cette année encore les « 13 èmes Journées Hypnotiques de Biarritz » ont été l’occasion de rencontres aussi enrichissantes que conviviales dans une ambiance presque familiale (tant on y retrouve des « habitué.e.s ») mais toujours animées d’un esprit de renouveau et de découverte. Merci à toute l’équipe d’Hypnosium* pour leurs efforts et leur accueil chaleureux.
- Vous trouverez sur le site d’Hypnosium*les entretiens filmés que j’ai réalisés mais voici aussi mes impressions sur les ateliers auxquels j’ai pu participer.
- « L’hypnose avant la parole ».
- C’est Christian Straus*, pneumologue et professeur de physiologie à Paris, qui ouvre la session de façon à la fois passionnante et très pratique. Il rappelle :
- Que le taux de SSPT* après un séjour en réanimation (où la dyspnée* joue un rôle important) est de 25 %.
- Que la respiration est la seule fonction contrôlée par le système nerveux autonome* sur laquelle nous pouvons agir.
- Que la respiration contribue à la conscience de soi (mais pas la fréquence cardiaque).
- Que l’action motrice (ou son imagination) se produit principalement pendant l’expiration alors que l’inspiration favorise la reconnaissance des émotions, la mémoire, la vision spatiale et améliore la discrimination des voix (et donc parler sur l’expiration permet de confondre la voix d’iel thérapeute et celle d’iel patient.e).
- Il présente de surprenantes expériences montrant scientifiquement que quelques séances d’hypnose permettent d’agir très efficacement sur la dyspnée* pendant plusieurs semaines.
- Enfin il évoque « Réexpiration », l’œuvre interactive de Samuel Bianchini autour de l’empathie respiratoire crée en collaboration avec les chercheurs du CHU Pitié Salpêtrière à Paris.
- C’est Christian Straus*, pneumologue et professeur de physiologie à Paris, qui ouvre la session de façon à la fois passionnante et très pratique. Il rappelle :
- « Amorcer la parole dans l’hypnose ».
- Pour sa conférence de clôture Christian Straus* donne un panorama des différentes influences auxquelles les patient.e.s sont exposés : les paroles qui créent une attente, les encouragements, les images nocebo*, les nudges*, les ancrages, les emplacements (cas des supermarchés), la durée de présentation (publicité), les stéréotypes , l’apparence, la faim, la fatigue, les amorçages* subliminaux, etc.
- Il présente une expérience où la simple lecture de liste de mots peut modifier le comportement moteur et/ou social des patient.e.s !
- Enfin il évoque brièvement les expériences d’« états non ordinaires de conscience sans suggestion » (EMI*, prises de psychédéliques) pour signaler que dans 90% des cas l’effet observé est une diminution de la peur de la mort.
- « Les régressions en âge ».
- L’atelier de Daniel Quin* est surtout destiné à mettre en garde contre les risques de cette régression et expliquer comment (et quand) l’utiliser en toute sécurité.
- Il est très difficile pour le patient.e de parler en régression complète, mieux vaut le faire après la transe profonde.
- La régression simplifiée est plutôt une hypermnésie* qu’une régression véritable.
- Pour pratiquer une régression complète iel thérapeute doit maitriser l’hypnose profonde* et mettre en place des fusibles de sécurité. Pensez à lire l’« Homme de février » de Milton H. Erickson*.
- Pour une phobie liée à un souvenir précis avec une échéance claire vous pouvez commencer par la question miracle* de De Shazer* sur un futur proche sans phobie, puis faire une séance d’hypnose avec réactivation à la demande. Si l’échéance est imprécise vous pouvez faire une régression avant l’expérience traumatique initiale (en essayant de bien connaitre le contexte : date, lieu, environnement, etc.) et la faire traverser confortablement par exemple avec une triple dissociation* (catalepsie*, lévitation*, dissociation* esprit/corps) avant de mettre en place un inducteur d’autohypnose* et de le tester à différentes étapes (J-1 ; J- 0.5 ; J0 ; J+1 ; etc.). Le fusible de sécurité pour la séance sera « Ma voix t’accompagnera et pourra prendre d’autres voix bienveillantes, etc. » (Phrase célèbre de Milton H. Erickson* que pour ma part je recommande à tous mes stagiaires de mettre systématiquement en début de séance d’hypnose même sans transe profonde programmée).
- Pour la technique inspirée de l’« Homme de février » il y a en transe profonde rencontre avec une personne qui a un geste positif (avec contact par le thérapeute) à différentes étapes de la vie du patient.
- Evitez la régression avec les déprimés. Cette technique n’a pas pour but de trouver quelque chose mais de faire quelque chose, d’agir, de donner un éclairage différent.
- Pour les cas modérés (anxiété, phobies, obsessions, compulsion) utilisez une transe moyenne confortable et fractionnée, renforcez le moi du patient.e puis revenez au moment pénible ou juste avant et faites le retraverser avec de nouvelles ressources (télécommande, etc.) et ratifiez le changement. Il y a alors modification de la carte cognitive.
- Pour les cas plus sévères (dépression, états limites, anxiété sévère) enchevêtrez bons et mauvais souvenirs (les mauvais pris en sandwich entre les bons) ou utilisez la technique de la boule de cristal* de Milton H. Erickson* avec les bons et mauvais souvenirs.
- Une autre option est de chercher l’analogie entre le phénomène pathologique et un phénomène de transe inverse et de le faire expérimenter en transe (hypermnésie* du déprimé/ amnésie* ; douleur/ analgésie*, etc.) et reprogrammer le chemin de vie.
- Sur le plan technique :
- Plus on va vers le passé, plus la voix doit venir de loin (direction, force, distance) et inversement pour revenir à une époque proche.
- Quand iel patient.e est en enfance passer du « vous » au « tu ».
- Quand la régression est obtenue le souvenir doit être vécu au présent.
- Pour le risque de faux souvenirs* il est préférable de faire régresser avant la période à visiter, puis de remonter le temps du passé vers le présent en racontant ce qu’iel voit au réveil, ainsi l’histoire vient de la personne. Puis utilisez les trois interrogations de Platon* : Est-ce vrai ? Est-ce bon ? Est-ce utile ?
- Pour restructurer le chemin de vie commencezpar prescrire la ½ h de passion (pire du pire) de Nardone* pour ancrer le symptôme, puis utilisez ce matériel pour remonter le temps étape par étape et régresser à l’expérience originelle à vivre pleinement en étant associé. Ensuite dissociez* afin de tirer les leçons de l’expérience et découvrir des ressources*, puis réassociez pour vérifier l’adéquation du nouveau comportement et le peaufiner éventuellement. Reprenezla route jusqu’au présent associé avec le changement positif et terminezla séance en vérifiant à nouveau que le pont vers le futur fonctionne.
- « Les métaphores en renfort ».
- Laure Watelet* propose une approche originale pour développer la créativité inspirée des spectacles de « matchs d’improvisation » où deux équipent s’affrontent (ou collaborent) dans des joutes verbales minutées à partir de thèmes proposés par le public ou les organisateurs et encadrées par un arbitre qui veille au respect de certaines règles : écouter, ne pas imposer, mettre les autres en valeur, être bienveillant, etc.
- Elle a donc créé un jeu de cartes pour mettre en situation : les thérapeutes tirent au hasard 5 cartes : l’objectif de soin, un mot à utiliser, une émotion du patient, une durée d’exercice et un « petit truc en plus » (magie ?). Après quoi il faut relever le défi dans le temps imparti.
- NB : contrairement aux vrais matchs les spectateurs/ices ne lancent pas de pantoufles ! Le jeu devrait être bientôt disponible, en attendant pourquoi ne pas découvrir un match d’impro ?
- « Comment « recycler » en hypnose l’univers du patient ».
- Marie-Clotilde Wurz de Baets*nous a expliqué (exemples et films à l’appui) comment chercher la bonne intention de la personne par l’observation visuelle et auditive.
- Elle nous a montré comment externaliser* le problème à partir d’un livre ou d’une expression, comment utiliser les clefs de désamorçage et les phrases refrains, comment utiliser les images, les photos personnelles et les relier aux émotions, comment observer et utiliser les mains.
- « Hypnose contre hypnose. La thérapie est un combat ».
- Dominique Megglé* nous rappelle les principes de base :
- Le malade douloureux est dans sa bulle hypnotique négative comme dans un cachot : misère et solitude. Il faut capter son attention.
- Le traitement c’est la RATIFICATION* de sa souffrance.
- Si le patient.e est réticent il est indispensable de le rendre disponible : ratification*, ratification*, anecdotes, petites histoires, choc, surprise, ennui (explications détaillées), etc. puis on peut s’attaquer au problème.
- Il y a 4 niveaux d’hypnose :
- L’entretien médical placebo*.
- La transe conversationnelle (le patient.e n’en est pas conscient).
- La transe légère-moyenne (ressentie par le patient.e).
- La transe profonde*.
- La stratégie est l’art d’arriver à un but (amélioration) en terrain inconnu (le patient.e).
- Quand on est dissocié on n’a pas d’émotion (Yves Halfon*).
- La ratification* de la plainte du patient.e permet de sortir de ses propres problèmes (amnésie de soi du thérapeute) et à un effet chez le patient.e.
- Dominique Megglé* nous rappelle les principes de base :
- « Le processus hypnotique commence avant la parole ».
- Pour Yves Halfon* l’hypnose commence dans le regard et la voix.
- Ce qui captive le nourrisson c’est la brillance des yeux et les basses fréquences de la voix. « Chanter à l’enfant c’est mieux que parler à l’enfant ».
- Il rappelle que pour Milton H. Erickson* : « L’hypnose c’est quand le sujet s’en remet à la voix » ; « La voix est un ancrage à l’enfance » ; « Toute conversation peut être hypnotique ».
- Pour Yves Halfon* : « Sans objectif la plainte tourne en rond » ; « Notre rôle est de passer du pourquoi au pour quoi ».
- Il expose ensuite les questions de base d’un entretien (le questionnement*) qui permettront d’orienter et d’alimenter le travail : Qu’est-ce qui vous amène ? Pouvez-vous imaginer un lieu où vous vous sentez bien ? Y avait-il dans votre enfance quelqu’un qui savait vous rassurer ? Comment avez-vous appris à faire du vélo ? Qu’est-ce que vos mains veulent nous dire (une main repousse ce que l’on ne veut plus, l’autre accepte les solutions) ? Demain comment saurez-vous que cela va mieux ? Si votre douleur avait une forme que serait-elle ?
- Puis il donne quelques pistes pour conduire la thérapie :
- « Anticiper la réussite c’est déjà la vivre une première fois ».
- « La métaphore c’est le langage de l’inconscient » (Freud*).
- « Permettez-moi de vous redire ce que vous venez d’exprimer » (il faut devenir le chroniqueur du patient).
- Et pour conclure : « La question est un outil, mais c’est la qualité de la rencontre qui en fait un levier thérapeutique. Les formes de questionnement ne sont que des outils, c’est l’alliance qui leur donne vie. Chaque question ouvre un passage, mais c’est le patient qui choisit d’y entrer. Chaque question est une porte et l’hypnose commence en l’ouvrant ».
- ADDICTIONS :
- « J’essaie d’arrêter de culpabiliser » : le long combat de Sandrine contre l’alcoolisme, une maladie dont beaucoup souffrent en silence ». franceinfo. 03 Octobre 2025. (06 mn).
- « Protoxyde d’azote : quelle place parmi les substances addictives ? » Medscape. 10 Septembre 2025. Les explications de Christophe Riou*.
- « Quand le cannabis déclenche l’hyperémèse chez les jeunes ». Medscape. 01 Octobre 2025. Je ne connaissais pas ces vomissements dus au cannabis et soulagés par les douches et bains chauds !
- « Aucun niveau de consommation d’alcool n’est sans danger pour le cerveau ». Medscape. 29 Septembre 2025. Une relation en U.
- « Comment lutter contre le protoxyde d’azote ? » Medscape. 10 Septembre 2025.
- « Protoxyde d’azote : quelle place parmi les substances addictives ? » Medscape. 10 Septembre 2025.
- « Protoxyde d’azote : une téléconsultation unique en France aux Hospices civils de Lyon ». Medscape. 12 Septembre 2025.
ANESTHESIE :
- « Se réveiller sous anesthésie : qui est à risque et pourquoi ? » Medscape. 12 Septembre 2025. Un risque, rare mais très traumatisant, à ne pas oublier pour lequel l’hypnose peut-être une grande aide. Quand il entendait des intervenants tenir des propos inappropriés pendant une intervention Dabney Ewin* disait, par précaution : « Je ne comprends pas ce qu’ils disent, ce doit être du chinois » pour induire une amnésie par confusion*.
COMMUNICATION :
- « Consentement éclairé : que retient le patient de vos explications ? » Medscape. 23 Septembre 2025. A quand un enseignement de la communication thérapeutique* dès le début des études de santé ?
- « Empathie des médecins : pourquoi certains patients se sentent moins écoutés ». Medscape. Prendre le temps nécessaire…
- « Comment la médecine de luxe redéfinit la valeur et la confiance des patients ». Medscape. 07 Octobre 2025. Pour inciter les médecins à se former à la communication (thérapeutique) : une bonne solution l’appât du gain !
- « La guerre des mots, avec Barbara Cassin ». France Culture. Le Book Club. 08 Octobre 2025. (58 mn). Politique et « novlangue ».
- « Mieux informer les patients sur la maladie d’Alzheimer ». Medscape. 25 Septembre 2025. Une campagne internationale en septembre.
- « Comment surmonter le choc de l’annonce d’un cancer ? ». France Inter. Le Mag de la vie quotidienne. 08 Octobre 2025. (24 mn). Une bonne émission avec Christophe André* (comme témoin et expert) et Violaine Forissier*, malheureusement nettement trop courte.
- « Santé mentale : peut-on encore s’informer sans déprimer ? » France Culture. 10 Octobre 2025. (59 mn). Grave question !
- « Médecins deepfake : comment l’IA propage la désinformation médicale ». Medscape. 29 Septembre 2025. Déprimant et inquiétant. Ce monde est fou !
COVID-19 :
- « La perte d’odorat peut persister pendant des années après la COVID-19 ». Medscape. 26 Septembre 2029. Sale virus…
DOULEUR :
- «L’acupuncture soulage les lombalgies chroniques et stimule les fonctions physiques ». Medscape. 26 Septembre 2025. Une étude sur 800 personnes.
- «Le cannabis pourrait-il redéfinir les soins contre la douleur pelvienne chronique ? ». Medscape. 25 Septembre 2025. Plutôt un effet placebo* !
- « Une alimentation saine soulage la douleur, et pas seulement grâce à la perte de poids ». Medscape. 07 Octobre 2025. Une nouvelle étude.
- « Un extrait de cannabis soulage les douleurs lombaires chroniques, améliore le sommeil et la mobilité ». Medscape. 01 Octobre 2025. Ne négliger aucun outil.
- « Est-il temps de reconsidérer le tramadol pour la douleur chronique ? » Medscape. 13 Octobre 2025. L’analyse d’un chercheur danois.
PEDIATRIE EDUCATION :
- « L’autisme n’est pas un trouble isolé, selon de nouvelles données ». Medscape. .03 Octobre 2025. Des différences selon la période de détection.
- « Est-il possible d’apprendre une langue étrangère avant la naissance ? » Santé magazine. 07 Octobre 2025. Je suis sûr que des coachs commencent à préparer leur campagne de pub pour inciter les parents (aisés …) à faire de leurs enfants des cracks dès l’utérus ! Une étude intéressante sera alors à faire : vérifier si la connaissance du sexe influencera l’investissement. Et si on se contentait de les aimer et de les laisser tranquilles tant que c’est encore possible… Non aux devoirs in utero !
- « L’attention en alerte ». Cerveau & Psycho. Braincast. Octobre 2025. (27mn 59). Les explications d’Yann Le Strat* sur le TDAH* et son traitement.
- « Les origines complexes de l’autisme : ce que la science révèle et ce qui nous attend ». Medscape. 10 Octobre 2025.
- « Et si nous prenions nos enfants au sérieux ? » France Inter. Le Mag de la vie quotidienne. 15 Octobre 2025. Une bonne émission autour de l’infantisme* et de l’éducation positive* avec Laelia Benoît*
PSYCHOLOGIE PSYCHIATRIE :
- « Mon psy utilise ChatGPT ». France Inter. 30 Septembre 2025. (04 mn).
SCIENCES & NEUROSCIENCES :
- « Les secrets de l’odorat ». Cerveau & Psycho. Braincast. Septembre 2025. (29 mn). Podcast gratuit avec Claire de March*.
- «Le silence fait littéralement pousser de nouveaux neurones dans votre cerveau ». Cérébral. 14 Septembre 2025.
- « Les interfaces cerveau-ordinateur suscitent des inquiétudes quant à la confidentialité neurologique ». Medscape. 23 Septembre 2025. Une réflexion indispensable.
- « Nous n’écoutons pas aussi bien immobiles, en marche ou dans un virage ». Sciences & Avenir. 08 Octobre 2025. Meilleure attention auditive quand nous marchons. Mais qu’en est-il de notre attention visuelle ?
- « Voyage dans vos images mentales ». Cerveau & Psycho. Braincast. Octobre 2025. (32 mn 21). Les explications de Paolo Bartolomeo* sur l’aphantasie*.
- « Vous voyez avec vos oreilles, littéralement ». Cérébral. 12 Octobre 2025. Découvrez l’Effet Bouba-kiki*.
- « Voir un avatar malade en réalité virtuelle déclenche le système immunitaire ». France Culture. 19 Septembre. (05 mn). L’hypnose aussi !
- « Le TDAH peut vous rendre plus créatif ». Neurosciences News.com. 13 Octobre 2025.
SEXOLOGIE :
- « Quand les GLP-1 modifient la libido des patients : ce qu’il faut savoir ». Medscape. 23 Septembre 2025. Un effet secondaire à connaitre et prendre en compte.
- «Parler de sexe reste un sujet tabou pour les médecins généralistes ». Medscape. 22 Septembre 2025. Le silence est rarement la bonne solution
SOMMEIL :
- «Le laboratoire japonais Takeda développe un nouveau traitement contre la narcolepsie aux résultats prometteurs ». franceinfo. 29 Septembre 2025.
- « Trop peu de sommeil peut entraîner une prise de poids excessive : que faire ? » Medscape. 25 Septembre 2025. Dormir !
- « Pendant que vous dormez, le cerveau fait le ménage ». Medscape. 30 Septembre 2025. Un des rôles du sommeil, à condition de dormir suffisamment…
- « Comprendre son sommeil ». Cerveau & Psycho. Braincast. Septembre 2025. (27 mn 38). Les explications de Damien Léger*.
- « Un sommeil de mauvaise qualité associé à un vieillissement cérébral accéléré ». Medscape. 08 Octobre 2025. Double peine !
THERAPIE :
- « Une étude mesure pour la première fois à quel point la santé mentale des aidants s’effondre ». France Inter. 06 Octobre 2025. (01 mn).
- « Fibromyalgie : améliorer la stratégie diagnostique et thérapeutique ». HAS. 30 Septembre 2025. (01 h 30 mn).
- « La kétamine intraveineuse surpasse l’eskétamine intranasale dans le traitement de la dépression ». Medscape. 10 Octobre 2025.
- « La mémantine améliore le fonctionnement social dans certains cas d’autisme ». Medscape. 10 Octobre 2025. De l’Alzheimer à l’autisme ! 21 % d’amélioration.
- « On apprend à ne pas s’agiter quand le patient est en crise » : immersion dans le quartier d’isolement d’un hôpital psychiatrique à Marseille ». franceinfo.fr. 10 Octobre 2025. (05 mn).
- « Applications sur la dépression : ont-elles un rôle dans la pratique clinique ? » Medscape. 30 Septembre 2025. Savoir tout utiliser ?
- « Lacune majeure » dans de nombreux essais contrôlés randomisés sur le trouble dépressif majeur ». Medscape. 14 Octobre 2025. Discussion sur les critères d’inclusion pour les adapter aux réalités du terrain.
- « La transplantation fécale est-elle efficace contre la dépression ? » Medscape. 13 Octobre 2025. Des résultats à confirmer.
TROUBLES DU COMPORTEMENT ALIMENTAIRE ET DIETETIQUE :
- « Gérer la confusion des patients concernant les aliments transformés ». Medscape. 26 Septembre 2025. Des notions utiles.
- « Quand les aliments « diététiques » sabotent la perte de poids : Guide du médecin pour l’éducation des patients ». Medscape. 07 Octobre 2025. Des conseils de base.
- « Pourquoi les médecins orientent rarement leurs patients vers la chirurgie bariatrique ». Medscape. 30 Septembre 2025.
- « L’activité physique produit une molécule coupe-faim ». Sciences & Avenir. 14 Octobre 2025. Le rôle de la lactoylphénylalanine chez la souris.
CONFUSION ET DETOURNEMENT D’ATTENTION :
- « Quel est l’ours le plus dépressif ? C’est l’ours bipolaire ».
HYPNOSE CONVERSATIONNELLE ET COMMUNICATION THERAPEUTIQUE :
- « Un tatouage, c’est un ancrage ». (BB).
OUTILS :
- « Lumnisexotrucs » : Un site gratuit pour parler sexualité avec les enfants.
VIDEOS :
- « Entretien avec le Professeur Christian Straus ». Hypnosium. JHB 2025. (09 mn). Hypnose et pneumologie.
- « Le traumatisme vicariant ». Hypnosium. JHB 2025. (07 mn 28). Entretien avec le Professeur Pierre Castelnau*.
VIE PROFESSIONNELLE :
- « Quand les psys abusent ». France Culture. Les pieds sur terre. 06 Octobre 2025. (30 mn). Deux témoignages sur des abus par un psychiatre adepte de la câlinothérapie* et un psychanalyste.
- « Prévention du suicide chez les professionnels de santé ». Medscape. 18 Septembre 2025.
- « Les médecins généralistes sont invités à se protéger de la fatigue de compassion ». Medscape. 13 Octobre 2025.
CHEMINS DE TRAVERSE :
- « Histoires de médecines alternatives, ça vous gratouille ou ça vous chatouille ? » France Culture. Le cours de l’histoire. 01 Octobre 2025. L’holisme* médical.
- « On se refait une santé ? » Artips. 14 Octobre 2025. Une approche intéressante et très pragmatique.
TURLUTUTU CHAPEAU POINTU :
- « Déprogrammation des sensibilités » : Méthode de ré-information vibratoire « Lumen care » pour calmer les sensibilités et intolérances (aux acariens, poussières, pollens, piqures d’insectes, alimentaires…).
- «Un dérivomètre pour informer des risques liés aux pratiques de soins non conventionnelles ». Bulletin de l’Ordre National des Médecins. Septembre 2025. Page 26.
VOCABULAIRE :
- « Boule de cristal » : Technique utilisée par Milton H. Erickson* qui consiste à demander aux patients en transe d’imaginer qu’ils regardent dans une boule de cristal et s’y voient tels qu’ils seront une fois le problème résolu. Ils décrivent ensuite les changements spécifiques qu’ils constatent.
- « Effet Bouba-kiki » : Corrélation entre la forme visuelle d’un objet et la suite de phones qu’on lui associe, observée pour la première fois par Wolfgang Köhler* en 1929.
- « Trouble de Stress Post Traumatique » ou « TSPT » ou « Syndrome de Stress Post Traumatique » ou « SSPT » : Trouble psychiatrique survenant après un traumatisme grave (subi ou observé) consécutif à une situation durant laquelle l’intégrité physique ou psychologique du patient, ou celle de son entourage, a été menacée ou effectivement atteinte (notamment en cas de torture, viol, accident grave, mort violente, maltraitance, négligence de soins de la petite enfance, manipulation, agression, maladie grave, naissance, guerre, attentat, accouchement) et où le patient a vécu une situation d’impuissance, ses capacités de réaction ayant été dépassées. Il associe généralement une hypervigilance, des reviviscences et des conduites d’évitement. Son traitement de référence est l’utilisation des mouvements alternatifs*.
CITATIONS :
« La métaphore c’est le langage de l’inconscient. »
Freud
« Cela s’est passé comme cela la semaine prochaine. »
Lewis Carroll
« Les angoisses et anticipations négatives ne sont pas seulement des comorbidités de l’insomnie, elles en font partie intégrante.…
S’imposer des nuits plus courtes, à horaires réguliers, favorise le retour à une bonne alternance de la veille et du sommeil. »
Isabelle Poirot.
La chronique du Dr Bruno Blaisse, Responsable média de l’ IMHE Biarritz Pays Basque – Hypnosium